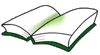| Titre : | L'entretien motivationnel : efficace et applicable pour réduire les pratiques d'injection à risque? (2016) |
| Auteurs : | Karine Bertrand, Auteur ; Karine Gaudreault, Auteur ; Élise Roy, Auteur |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | ADDICTION(S) : RECHERCHES ET PRATIQUES (n°1, décembre 2016) |
| Article en page(s) : | pp. 25-28 |
| Langues: | Français |
| Catégories : | |
| Résumé : |
L’accès à du matériel d’injection stérile est reconnu comme une pratique efficace en réduction des méfaits permettant de diminuer les pratiques d’injection à risque (PIR). Toutefois, la persistance des PIR chez certaines personnes UDI souligne l’importance d’offrir une diversité d’interventions en vue de mieux répondre à leurs besoins. Ces personnes se présentent sporadiquement dans les services et peuvent manifester peu d’intérêt à s’engager dans des suivis demandant des rencontres multiples, ou encore éprouver des difficultés à surmonter divers obstacles à leur implication dans un suivi (Kidorf et coll., 2012). Ainsi, les interventions brèves offertes en milieux de proximité sont à privilégier pour mieux aider ces personnes (Meader et coll., 2010; WHO, 2012). L’entretien motivationnel (EM) est une intervention dont l’efficacité a été démontrée dans plusieurs domaines de santé, notamment sur le plan des addictions (Lundahl et Burke, 2009). L’EM se définit comme « un style de communication collaborative et centrée sur un objectif, (…), conçu pour renforcer la motivation d’une personne et son engagement en faveur d’un objectif spécifique en faisant émerger et en explorant ses propres raisons de changer » (Miller et Rollnick, 2013, p. 30). Toutefois, l’application de l’EM auprès de personnes UDI ainsi que dans un contexte de réduction des méfaits, en vue de réduire des PIR, n’a jamais fait l’objet d’une étude d’efficacité à notre connaissance, sauf pour celle de Baker et coll. (1994). Cette dernière étude ne permet pas d’arriver à des résultats concluants, mais les forts taux d’attrition limitent les conclusions que l’on peut en tirer. Cette étude a pour objectifs de : 1- comparer l’efficacité de deux types d’interventions brèves, l’EM et une intervention éducative (IE), sur les PIR chez les personnes UDI (Bertrand et coll., 2015) ; 2- documenter la perspective des personnes UDI qui ont reçu l’une ou l’autre de ces interventions. (extrait de l'article) |
| Note de contenu : | graph.;biblio. |
| En ligne : | https://feditobxl.be/site/wp-content/uploads/2017/02/ARP_numero1_versionweb_v2.pdf |
Exemplaires (1)
| Cote | Code-barres | Support | Localisation | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|
| REV ARP 2016 1 | NA000003 | Bulletin | NADJA | Consultation sur place Disponible |