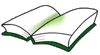|
Résumé :
|
« Handicap », comme mot, est de plus en plus saillant, et comme catégorie, est de plus en plus hétérogène. Des groupes d’intérêt multiples et des professions définissent le handicap de différentes manières, de sorte qu’il est impossible d’obtenir une définition théorique unique ou un seul modèle d’explication du handicap comme phénomène. Il est dans l’intérêt à la fois des chercheurs du handicap et des personnes handicapées de reconnaître cette compréhension multiple du handicap et de s’approprier des manières de penser et de parler du handicap, qui peuvent souvent être considérées comme antinomiques à une compréhension progressiste du handicap. Cela est particulièrement vrai pour le langage médical, qui peut être mobilisé pour approfondir notre analyse du handicap sans que celle-ci soit associée au traditionnel problème de la médicalisation. Un tel projet requiert un engagement étroit avec les particularités du langage médical, mais aussi avec la maladie chronique, qui est parfois dissociée de la déficience, sur des bases fallacieuses. Les recherches sur le handicap devraient reconnaître l’utilité du langage médical comme outil permettant aux personnes atteintes d’une maladie chronique ou de déficiences, de conceptualiser leur expérience incarnée. Elles devraient s’interroger sur les manières de situer le langage médical dans une compréhension socio-politique progressiste, de la maladie chronique, de la déficience et du handicap.
|