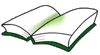|
Résumé :
|
"il a semblé opportun à ""l’Ecole des parents"" de revenir sur cette question du jeu, un peu délaissée du champ scientifique. Parce que les jeux actuels, de plus en plus formalisés, laissent de moins en moins place à la gratuité et à la créativité, justement. Et parce que l’arrivée massive des jeux vidéo, au-delà de l’inquiétude qu’ils suscitent chez les parents, a considérablement modifié la donne. Contribuent-ils, autant que les jeux traditionnels, à développer l’imaginaire et les compétences intellectuelles des enfants et des adolescents? Quel rôle jouent-ils dans leur socialisation? [...] Les jeux vidéo, sous réserve que leur usage reste modéré, non exclusif et peu précoce, participent à leur manière à la construction de l’enfant. Ils ont d’ailleurs fait une entrée remarquée dans les cabinets des psychologues, convaincus par leurs vertus thérapeutiques. Il ne s’agit pas, toutefois, de délaisser les jeux traditionnels (jeux de manipulation, de société, jeux symboliques ou physiques), aussi indispensables pour maîtriser son corps, développer ses habiletés manuelles et sociales, que pour tisser des liens, avec ses parents puis avec ses pairs. N’oublions pas non plus de laisser une place à l’ennui, si précieux pour enrichir son imaginaire, échafauder ses pensées, apprivoiser la solitude et créer. La rêverie n’est-elle pas la forme ultime du jeu? [Extrait de l'édito]."
|