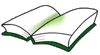|
Résumé :
|
À partir d’une revue de la littérature sur l’émergence de différentes catégories désignant les «maux» du travail, telles que l’usure, le stress, la violence et le harcèlement, nous tentons de repérer à la fois les rémanences dans les modalités de saisie de la problématique santé et travail et la méconnaissance qui les accompagne. La nouvelle catégorie des «risques psychosociaux» s’inscrit dans cet héritage. Elle reproduit et renouvelle partiellement les enjeux associés à ces constructions socio-historiques. En effet, le lien entre la santé et le travail est toujours saisi à travers le prisme des effets délétères de ce dernier: la question de la santé des «sans-travail» et le travail comme source de santé sont occultés. Les jeux d’imputation causale se prolongent opposant les tenants de «l’exposition aux risques» et ceux de la «prédisposition des fragiles». Face à l’individualisation des questions de santé et à l’amplification des tendances eugénistes, l’omerta sur les difficultés et problèmes de santé «personnels» se développe. Mais ce pourrait être là une forme de résistance contre-productive car elle contribue à l’usure et à la solitude de chacun face à l’expérience inéluctable d’une fragilité qui n’est pas personnelle mais humaine, ontologique.
|