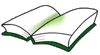|
Résumé :
|
La société occidentale a connu des changements sociaux majeurs depuis quatre décennies, conduisant à passer de la première modernité, avec son programme institutionnel fort, encadrant les conduites de chacun comme l'éducation des enfants, à une seconde modernité dans laquelle l'individu est au cœur de la construction du social, source et légitimation de ses conduites. De nouvelles coordonnées de la famille en découlent. Elles sont centrées maintenant sur le consensus à la place de l'autorité pour organiser les rapports entre ses membres, sur l'hédonisme en lieu et place du devoir comme valeur centrale. L'enfant a une nouvelle place, c'est l'enfant du désir, reconnu d'emblée dans son individualité — «le bébé est une personne» —, enfant fait «pour soi et pour lui». L'environnement de vie de l'enfant est aussi transformé par la place croissante des médias, que l'on peut comparer à un «troisième parent», par les modifications des rapports de couple, avec la précarisation conjugale, et de genres conduisant à une évolution marquée des rôles masculins et féminins. Ces modifications conduisent à une structuration de la psyché de l'enfant qui n'est plus sur le modèle névrotique. Dans ce contexte inédit, nous proposons l'hypothèse d'une nouvelle personnalité de base, traduction des nouveaux repères de la société et de la famille et conséquences des nouvelles pratiques d'éducation des enfants, qui viendrait remplacer la personnalité de base névroticonormale qui a dominé au cours de la première moitié du XXe siècle. Cette personnalité de base, que nous proposons d'appeler «narcissicohédoniste», présente des caractéristiques spécifiques: une modification des caractéristiques des instances, (Surmoi moins contraignant, Idéal du moi peu socialisé), une absence presque totale de culpabilité, une pulsionnalité moins contrainte, une propension aux engagements choisis avec une méfiance à l'égard de ceux qui sont imposés, un mélange de réflexivité et de spontanéité, et un effort incessant de définition de soi, associé souvent à une difficulté à «être», à s'éprouver comme un sujet libre. Les pathologies issues de cette personnalité de base seraient dans les registres fréquemment considérés comme états limites, pathologie narcissique ou troubles des conduites.
|