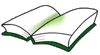|
Résumé :
|
Objectifs: face à l'hétérogénéité de la prescription et des modalités de sevrage du patient alcoolo-dépendant, la Société française d'alcoologie a organisé en 1999 une conférence de consensus pour promouvoir des recommandations de bonnes pratiques, notamment sevrage ambulatoire en première intention, préconisation médicamenteuse, accompagnement psychosocial. En l'absence de dispositif intégré d'évaluation de l'impact de la conférence, l'objet de l'article est de voir s'il est possible de déceler, cinq ans après la diffusion des recommandations, une évolution positive des pratiques de prescription de sevrage tant en médecine générale que dans les structures spécialisées. Méthode: elle repose sur l'analyse statistique comparative de données issues des dossiers médicaux de patients ayant effectué un sevrage en ville (326) ou en institution (153) en 1999 et 2005. Résultats: en médecine générale, on note entre 1999 et 2005 un engagement plus fort des médecins. Le nombre de patients sevrés a doublé en valeur absolue (49/97) et leur proportion par rapport aux patients déclarés alcoolodépendants est passée de 42 % à 47 %. On observe également une tendance à l'harmonisation des pratiques de sevrage, avec par exemple une augmentation, bien que non significative, des prescriptions de benzodiazépines (BZD, 56,3 % en 1999,64,9% en 2005). De même, un accompagnement psychosocial est mis en place pour 25 % des patients au lieu de 13 %. Le mouvement d'adhésion aux recommandations s'avère très significatif pour les sevrages en milieu spécialisé. Ainsi, le taux de prescription de BZD seules ou associées est passé de 64,8 % en 1999 à 97,5 % en 2005, et la durée de traitement a été réduite de 13,2 à huit jours. Discussion: au-delà des limites méthodologiques, la discussion souligne les différences de patientèle entre généralistes et services spécialisés, ainsi que la spécificité mais aussi la complémentarité de leurs pratiques respectives.
|