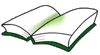|
Résumé :
|
La prévention conventionnelle comporte plusieurs impasses qui sont à l'origine de ses échecs. Elle se concentre sur le produit en tant que facteur de dangers et, surtout, elle ne prend pas en considération le besoin de mieux être que recouvrent les consommations de substances psychoactives. Ce malentendu entache fondamentalement cette prévention, notamment envers les jeunes : la consommation des substances psychoactives, quelles qu'elles soient, répond avant tout à une recherche de satisfactions. Celle-ci est un besoin constant chez les hommes, mais n'est pas toujours reconnue comme tel, tant les activités qui y sont liées se trouvent au cœur de la question morale: jusqu'où est-il acceptable d'aller? Une question de choix individuel, mais un choix culturellement et socialement fortement déterminé. Les consommations de substances psychoactives sont aujourd' hui constitutives du champ de l'expérience des individus, particulièrement à l'adolescence. Une expérience à borner et à limiter bien sûr, à accompagner surtout pour qu'elle prenne sens. L'auteur propose un modèle addictologique global permettant d'intégrer les dangers comme les plaisirs que comportent les drogues. Il propose aussi des voies de développement d'une prévention qui s'inscrivent dans la culture et au plus près de l'expérience individuelle.
|