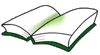|
Résumé :
|
"La principale raison de la relation particulière entre le cannabis et la littérature, dans la France de la seconde moitié du 19ème siècle, tient à ce que les effets de cette drogue, tels que les décrivent ses usagers (pour la plupart des écrivains ou des artistes), coïncident dans une certaine mesure avec les grands courants de l'esthétique de l'époque. En premier lieu, le fantastique, c'est-à-dire l'évasion hors de limites de la réalité sans qu'interviennent des facteurs appartenant à l'héritage religieux ou folklorique traditonnel. En second lieu, un intérêt croissant pour les aberrations sensorielles, les pouvoirs de l'imagination, l'élargissement de son domaine dans le rêve ou la folie. Enfin, la parenté entre les états psychiques engendrés par la drogue et un certain mode de fonctionnement du langage (notamment les fameuses ""correspondances"") dont la littérature romantique et post-romantique tire le plus grand profit. Initiés par Théophile Gautier, théorisés (avec une certaine ambiguïté) par Charles Baudelaire, ces parallélismes, qu'exploite avec complaisance la littérature dite ""décadente"", trouvent en Henri Michaux un observateur intéressé, mais en même temps soucieux de rester sur sa réserve."
|