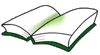|
Résumé :
|
L'auteur voudrait d'abord montrer que pauvreté, marginalité et exclusion peuvent être considérés non comme des phénomènes en soi, mais comme des constructions sociales, et cela en deux sens distincts : un premier sens, assez classique, où on considère que le fonctionnement économique produit à la fois des riches et des pauvres, avec des conséquences sur ce qu'on nomme aujourd'hui le lien social, un deuxième sens, moins connu, où l'accent de l'analyse est mis sur les groupes sociaux qui produisent les normes des comportements socialement acceptables et appliquent le label de déviant ou de marginal aux personnes qui vivent en dehors de ces normes ou qu'ils jugent vivre en dehors de ces normes.|Dans un second temps, l'auteur s'interrogera sur la manière dont la société administre et a administré ces marges, les logiques repérables sont nombreuses, mais elles peuvent être décrites dans une tension entre deux extrêmes très contrastés : on trouve d'un côté une logique principale où l'aide est dominée par le contrôle social, et de l'autre côté une logique minoritaire où les aspects de contrôle social sont volontairement combattus et où l'aide aux exclus passe par l'apport de ressources matérielles et symboliques et par la reconnaissance de leurs droits à exister comme sujets et citoyens, porteurs d'une identité positive, capables de gérer l'opposition, dynamisés par la formulation de projets individuels ou collectifs.
|