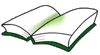|
Résumé :
|
Le visage représente symboliquement le support de l’identité. Dans un service de chirurgie maxillo-faciale, les visages malformés et défigurés constituent une clinique de la monstruosité faciale. Fréquemment verbalisée, la référence à la monstruosité apparaît comme une évidence et partage avec la difformité faciale ses caractéristiques principales : archaïsme, démesure, paradoxe et hybridité. La catégorie du monstrueux éclaire les processus psychiques pris au cœur de la difformité faciale, où la subjectivité se retrouve souvent mise à mal. Pour s’approprier ce visage monstrueux, les patients peuvent mettre en œuvre leurs capacités créatrices à travers des théories somatiques infantiles où émergent des processus archaïques accueillis dans l’écoute clinique. Dans cette clinique si particulière, la dimension spéculaire est prégnante, et le psychologue doit alors repenser sa posture clinique : si la rencontre avec le sujet constitue l’occasion d’une mise en mots du visage monstrueux, le clinicien remplit aussi un rôle de miroir symbolique. Des cas cliniques illustrent la pertinence de ce double mouvement dans l’espace psychothérapeutique, s’appuyant sur le langage et le regard, pour soutenir un travail de (re)subjectivation et de reconstruction narcissique, et accompagner le sujet vers une (ré)appropriation de son visage.
|