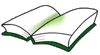|
Résumé :
|
Dans ce texte, l’auteur s’interroge sur les relations entre la manière de définir ce qu’est une vie bonne et le concept de normalité. Ancrant sa réflexion philosophique dans son expérience personnelle, celle d’une fille de parents juifs ayant survécu à l’Holocauste, puis celle de mère d’une enfant atteinte d’un handicap cognitif sévère, elle montre que les relations entre la normalité et la vie bonne sont complexes. Être identifié comme normal semble en effet constituer une condition de la vie bonne, comme en atteste le désir de normalité qui habite la plupart d’entre nous. Pourtant, l’expérience du handicap révèle qu’une vie heureuse est possible en marge des normes dominantes, et conduit à repenser à la fois la normalité et la vie bonne. L’auteur invite ainsi à ressaisir la normalité à partir des processus de construction des normes, de manière à favoriser la constitution de normes alternatives. Quant à l’idée de vie bonne, elle souligne qu’elle doit être pensée au pluriel et que, pour des êtres relationnels, elle ne saurait se résumer à l’idée d’une vie rationnelle, raisonnable ou performante, et repose bien davantage sur la capacité à être et à nouer des relations.
|