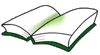|
Résumé :
|
Depuis la fin des années 1990 et la disponibilité d’antirétroviraux hautement actifs dans les pays occidentaux, le VIH/sida y est devenu une maladie chronique. À ce titre, il nécessite un aménagement de la vie dans la dépendance à la médecine. Les patients effectuent un « travail » souvent invisible pour se soigner, enchaîner des recours multiples, les coordonner entre eux et avec leurs activités courantes. Il consiste à se mettre en situation d’accéder aux soins, à anticiper la dégradation de leur santé, à développer en situation des techniques pour ajuster leurs recours entre eux et à leurs attentes qui évoluent. Ce travail a été étudié sous l’angle de la mobilité socio-spatiale dans une thèse de sociologie sur les « parcours urbains de soins » de personnes vivant avec le VIH/sida. Des récits de vie recueillis à Bruxelles et à Rouen et analysés selon la méthode typologique ont permis de l’appréhender. La mise en évidence de modes d’action rend compte de ce travail des personnes séropositives dans deux séquences de la vie avec le VIH : l’installation dans le diagnostic et l’aménagement de la vie dans la dégradation potentielle ou effective de la santé. Elle éclaire différentes définitions de la qualité des soins pour les patients et leurs façons de circuler dans l’offre de soins pour l’obtenir. Dans la collecte d’entretiens, l’étude a rencontré les mêmes difficultés que des recherches qualitatives antérieures sur le VIH/sida. L’approche par la mobilité des malades chroniques livre des enseignements utiles à l’organisation des soins
|