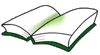|
Titre :
|
Inclusion et participation sociales des personnes en situations de handicap : opportunités et tensions. Réflexions autour de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées (2015)
|
|
Auteurs :
|
William Sherlaw ;
HUDEBINE H. ;
EHESP (Ecole des hautes études en santé publique) ;
UNIVERSITE DE BRETAGNE
|
|
Type de document :
|
Article : texte imprimé
|
|
Dans :
|
Alter (Vol. 9 n° 1, Janvier-Mars 2015)
|
|
Article en page(s) :
|
pp.9–21
|
|
Note générale :
|
biblio.
|
|
Langues:
|
Français
|
|
Catégories :
|
HANDICAP
PROMOTION DE LA SANTE
SURDITE
PARTICIPATION COMMUNAUTAIRE
BIEN-ETRE
|
|
Mots-clés:
|
HANDICAP
;
PROMOTION DE LA SANTE
;
SURDITE
;
PARTICIPATION COMMUNAUTAIRE
;
BIEN-ETRE
|
|
Résumé :
|
La Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées ouvre des opportunités pour la promotion de politiques inclusives. La Convention peut également être utilisée comme référence pour évaluer les politiques dont le but est d’améliorer la vie des personnes handicapées. À cette fin, il est essentiel que les priorités de l’évaluation soient déterminées sur la base d’une méthode de recherche participative qui accorde une place centrale aux personnes handicapées, en particulier celles avec qui il est difficile d’établir un contact. Dans cette perspective, il est important de souligner que les objectifs communs aux différentes organisations représentant les personnes en situation de handicap transcendent les tensions qui peuvent parfois exister entre elles. Il est également crucial que l’évaluation des politiques s’effectue en fonction de définitions et d’objectifs clairs. Le concept d’inclusion est traversé par des tensions fondamentales, qu’il est vital de prendre en compte. On songe en particulier aux tensions qui peuvent exister entre les programmes de justice sociale fondés sur la redistribution et ceux qui sont fondés sur la reconnaissance. La question des implants cochléaires et du dépistage de la surdité chez les enfants illustre particulièrement bien ce dilemme. Il n’en demeure pas moins qu’il est crucial que ces deux dimensions conservent leur place dans les programmes d’action publique. L’un des moyens d’y parvenir consiste à mettre en place des processus délibératifs participatifs offrant à chacun le même statut et la possibilité d’exprimer son point de vue sur une base égalitaire et paritaire. Au final, les tensions associées aux processus participatifs et aux principes qui fondent l’inclusion impliquent que des choix sont nécessaires pour agir. Il est préférable que ces choix soient effectués par les personnes handicapées elles-mêmes, sur la base de recherches-action dans lesquelles elles auront été impliquées.
|
|
Note de contenu :
|
SCIENTIFIQUE
|