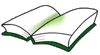| Titre : | Violences gynécologiques et obstétricales: comprendre pour agir : Violences gynécologiques et obstétricales, technologies biomédicales et avortement dans une maternité publique du nord-est du Brésil (2021) |
| Auteurs : | Mariana Ramos Pitta Lima, Auteur ; Cecilia Anne McCallum, Auteur ; Cecilia Anne McCallum, Auteur ; Greice Maria de Souza Menezes, Auteur |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Santé publique (Vol. 33 n°5, septembre-octobre 2021) |
| Article en page(s) : | pp. 675-683 |
| Langues: | Français |
| Catégories : | |
| Résumé : |
"Introduction : Le Brésil a une législation qui restreint la pratique de l’avortement. Dans le pays, il s’agit d’un problème de santé publique important en raison de la morbidité, de la mortalité et des hospitalisations dues ont la pratique des avortements à risque. Au Brésil, les complications liées aux avortements provoqués et spontanés sont traitées dans les « maternités », où des violences obstétricales peuvent être perpétrées.
But de l’étude : Analyser, à partir de données ethnographiques, les pratiques des technologies biomédicales et leurs rapports avec les violences gynécologiques et obstétricales. Résultats : Trois pratiques principales sont systématisées, à des fins didactiques : le traitement des complications de l’avortement à la maternité, l’échographie et le curetage. Malgré l’existence de normes nationales – résultat des avancées du mouvement sanitaire et féministe brésilien – et de normes internationales, il subsiste une résistance institutionnelle à l’adoption de pratiques qui donnent la priorité au bien-être des femmes. Conclusions : Le mode d’organisation et de matérialisation du service et l’adoption de certaines pratiques et technologies (ainsi que l’omission d’autres) reproduisent les violences obstétricales. Les pratiques quotidiennes à l’hôpital n’échappent pas à la moralisation de l’avortement, et aux fortes inégalités de classe, de race et de genre qui dépassent l’espace institutionnel de l’hôpital. L’analyse nous permet de comprendre que la pratique des technologies biomédicales façonne et est façonnée de manière symbolique et située, et peut servir d’instrument pour les pratiques de violence incarnée. Enfin, il est nécessaire de revoir le modèle des soins post-avortement." |
| Catalogueur : | RESOdoc |
Exemplaires (1)
| Cote | Code-barres | Support | Localisation | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|
| RESO S.18 | RE65682252 | Bulletin | RESOdoc | Consultation sur place Disponible |