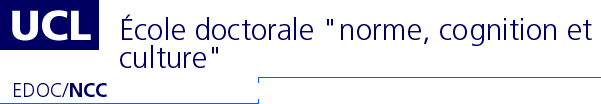
|
|||||||||||
|
|||||||||||
Ecole doctorale "Norme, cognition et culture"Organisation et composition
|
|||||||||||
|
Place du Cardinal Mercier, 10 1348 Louvain-la-Neuve |
||
|
Tél. 010474821 |
||
|
Président : Vincent Yzerbyt |
|
|
|
Secrétaire : Vinciane Desnoeck |
Tél. 010474821 |
|
|
|
|
Comité de gestion
Professeurs Bernard Coulie (coulie@ori.ucl.ac.be), Pierre Feyereisen (pierre.feyereisen@psp.ucl.ac.be), Michel Francard (francard@rom.ucl.ac.be), Jacques-Philippe Leyens (Jacques-Philippe.leyens@psp.ucl.ac.be), Guy Lories (guy.lories@psp.ucl.ac.be), Ginette Michaux (michaux@rom.ucl.ac.be), Marie-Pascale Noel (marie-pascale.noel@psp.ucl.ac.be), Pierre Philippot (pierre.philippot@psp.ucl.ac.be), Pierre Piret (piret@rom.ucl.ac.be), Jean-Claude Polet (polet@rom.ucl.ac.be), Bernard Rime (bernard.rime@psp.ucl.ac.be), Xavier Rousseaux (rousseaux@mage.ucl.ac.be), Laurence Van Ypersele (vanypersele@cont.ucl.ac.be), Vincent Yzerbyt (vincent.yzerbyt@psp.ucl.ac.be).
 Écoles, départements et centres ayant rapport avec les
études
Écoles, départements et centres ayant rapport avec les
études
Entités partenaires
- Centre de recherche Joseph Hanse (FLTR/ROM)
- Centre de recherche VALIBEL (FLTR/ROM)
- Institut orientaliste (FLTR/GLOR)
- Unité cognition et développement (PSP/CODE)
- Unité de Psychologie clinique : émotion, cognition, santé (PSP/ECSA)
- Unité de psychologie sociale et des organisations (PSP/PSOR)
Objectifs
Fondée en 1998 à l'initiative de chercheurs de l'U.C.L. appartenant aux facultés de droit, de philosophie et lettres, de psychologie et de sciences philosophiques, l'Ecole doctorale " Norme, cognition et culture " privilégie une approche transdisciplinaire ainsi que le questionnement épistémologique et méthodologique.
Elle regroupe à Louvain-la-Neuve une vingtaine de professeurs et de chercheurs permanents, engagés dans des réseaux de recherche régionaux, fédéraux (Actions de recherches concertées et pôles d'attraction interuniversitaires) et internationaux.
Les entités de recherche qui la constituent offrent aux doctorands un milieu propice à la recherche de haut niveau en sciences humaines, un encadrement stimulant et les instruments de travail nécessaires (matériel informatique, bibliothèque, etc.).
Plus de cinquante doctorands sont actuellement inscrits dans l'une des cinq filières de formation suivantes:
I. Littérature, histoire et esthétique
II. Langues, linguistique et anthropologie culturelle
III. Cognition, communication et interventions cliniques
IV. Psychologie sociale
V. Histoire, justice et société.
Gestion de la formation
La formation, qui combine des approches disciplinaires pointues et une ouverture à d'autres champs du savoir, repose non seulement sur des séminaires organisés au sein de chaque filière, mais aussi sur des activités animées par des professeurs étrangers invités et sur des activités transversales prises en charge conjointement par plusieurs filières.
Renseignements et admission
La formation est accessible aux porteurs d'un diplôme de deuxième cycle en sciences humaines qui s'inscrivent dans un projet de recherche porté par l'une des équipes constituant l'Ecole doctorale " Norme, cognition et culture ".
La langue de travail du programme est le français, cependant certains cours sont donnés en anglais. L'encadrement personnalisé du chercheur peut être fait en français ou en anglais. De même, les travaux peuvent être écrits et présentés en français ou en anglais.
La commission de gestion de l'Ecole doctorale admet le candidat à l'inscription, après examen de son dossier (comprenant un curriculum vitae, une demande motivée, ainsi qu'une présentation du projet de recherche). La commission de gestion de l'Ecole doctorale approuve en outre le programme de formation à la recherche choisi par l'étudiant.
La réalisation d'un doctorat dans l'école doctorale implique l'inscription aux programmes de doctorat et de DEA de l'UCL.
Toutefois, le programme de l'école doctorale ayant l'équivalence d'un DEA, les étudiants inscrits dans l'école doctorale ne sont tenus de suivre les programmes facultaires, ou départementaux de DEA. Le minerval payé pour les inscriptions au DEA et au doctorat couvre tous les frais d'inscription à l'école doctorale. Si la participation aux activités de l'école doctorale n'est pas liée à une recherche doctorale, seule une attestation de participation sera délivrée. Dans cette hypothèse, les frais d'inscription seront fonction du nombre d'activités effectivement suivies.
Les candidats peuvent prendre contact au préalable avec le directeur de l'Ecole doctorale qui leur fournit les informations nécessaires. Les dossiers, soumis pour approbation à la Commission de gestion de l'Ecole doctorale, doivent être rentrés au plus tard le 15 septembre de l'année pour laquelle l'admission est demandée, via la filière choisie. Les candidats retenus reçoivent les programmes et les autres indications utiles au plus tard le 1er octobre.
Thèmes de recherche
La formation est développée en cinq filières :
I. Littérature, histoire et esthétique
II. Langues, linguistique et anthropologie culturelle
III. Cognition, communication et interventions cliniques
IV. Psychologie sociale
V. Histoire, justice et société.
Filière " Littérature, histoire et esthétique "
Cette filière, organisée par le Centre de recherche Joseph Hanse. Littératures de langue française : théorie littéraire et littérature comparée (FLTR/ROM) lequel soutient des recherches dans le domaine des lettres belges - notamment en relation avec les littératures francophones et les littératures européennes - et, plus largement, des littératures de langue française. L'orientation de ces recherches est déterminée par un postulat fondamental, à savoir l'hétérogénéité de l'espace littéraire de la langue française. Il s'agit de reconnaître, à l'inverse des études littéraires traditionnelles, que la production littéraire écrite dans une même langue, mais dans des contextes historiques différents, constitue un objet complexe, qui ne se laisse pas réduire à un schéma unifié, mais requiert la mise en oeuvre de modèles analytiques diversifiés.
La filière a pour objectif de fournir les fondements théoriques et les instruments méthodologiques permettant de penser le fait littéraire dans sa double inscription historique et esthétique : comment et pourquoi les procédés, fonctions et effets esthétiques qui singularisent le fait littéraire dans le champ des discours lui confèrent-ils un mode d'être historique particulier ? Selon les problématiques travaillées, les exemples seront choisis dans diverses littératures et à diverses époques. Par là même, la filière s'adresse à tous les doctorands qui souhaitent interroger les relations complexes qui unissent littérature, histoire et esthétique.
La formation tentera d'articuler entre elles deux perspectives différentes mais complémentaires. D'une part, dans une perspective génétique, on verra comment les méthodes historiques (recours aux archives, référence aux contextes, etc.) permettent d'analyser l'émergence de l'oeuvre littéraire. D'autre part, dans une perspective théorique, on interrogera la validité des modèles d'analyse littéraire actuellement en vigueur et l'intérêt de certains paradigmes qui traversent les sciences humaines pour leur mise à jour.
Programme des étudiants (300 h)
90 heures de séminaires à orientation disciplinaire (rubrique 1)
60 heures de séminaires à orientation thématique (rubrique 2)
30 heures d'encadrement méthodologique (rubrique 3)
30 heures de formation à choisir parmi les activités " ouvertes " des autres filières.
NB. Des aménagements au programme type de l'étudiant peuvent être sollicités auprès de la Commission de gestion de l'Ecole doctorale.
Filière " Langues, linguistique et anthropologie culturelle "
Cette filière associe des membres de l'Institut orientaliste (FLTR/GLOR) et du Centre de recherche VALIBEL (FLTR/ROM) ainsi que des spécialistes des sciences du langage (provenant essentiellement d'ESPO, de FLTR et de PSP). Ces chercheurs ont en commun, dans leurs domaines respectifs, de poser la question de la compréhension et de la gestion de la diversité à l'intérieur de chaque société humaine, diversité qui se manifeste aussi bien dans des traits apparents (langues, cultures, etc.) que dans des traits comportementaux ou des représentations mentales moins immédiatement perceptibles (adhésion à des valeurs, à des normes, etc.).
Il s'agit de mesurer l'ampleur et les conséquences des transformations pour nos contemporains appelés à vivre demain dans des sociétés où les différences de toute nature seront constitutives de l'ensemble des interrelations, alors que la socialisation et la scolarisation d'aujourd'hui restent majoritairement fondées sur l'adhésion à des valeurs ethnocentriques et sur la transmission de ces valeurs.
Ces questions sont traitées au travers de deux thèmes de recherche : la diffusion des textes et des idées (Institut orientaliste) et les rapports entre langues et identités collectives (Centre de recherche VALIBEL). La recherche relative à la diffusion des textes et des idées part de cas concrets de sources littéraires anciennes ayant connu une diffusion large. Il s'agit en particulier de textes ayant fait l'objet d'une diffusion par traductions dans d'autres langues et étant ainsi entrés en contact avec des milieux et des cultures différentes. Sont analysés d'une part les processus de transmission des textes, d'autre part le phénomène de réception des textes dans les différents milieux, les adaptations subies par les textes pour s'adapter à ces milieux et l'influence des textes sur ces milieux. La recherche s'efforce de montrer comment des cultures différentes peuvent se développer en puisant leurs valeurs, leurs idées et leurs éléments identificateurs spécifiques en partie à des sources communes. L'étude de cas privilégiée est celle des oeuvres de Grégoire de Nazianze et de leur rôle dans la constitution de l'identité culturelle de l'Orient chrétien.
La recherche " Langue(s) et identité(s) collective(s) " analyse les rapports entre langue(s) et identité(s) collective(s), et plus particulièrement des fondements linguistiques (pratiques et représentations linguistiques) qui interviennent dans la construction d'une identité collective. Il s'agit d'une démarche transdisciplinaire, qui associe l'approche linguistique à celles que proposent l'anthropologie culturelle, l'histoire, la psychologie sociale et la philosophie. Toutes ces disciplines ont en commun de s'interroger sur la transformation des locuteurs en rapport avec l'organisation de leur contexte de parole. La mise en évidence des différents aspects de cette dynamique permettra d'aborder la formation des identités collectives comme un échange négocié entre les acteurs sociaux et leur environnement institutionnel. Cette analyse sera appliquée au monde francophone, au départ de trois études de cas: la Communauté française Wallonie-Bruxelles, le Québec et un pays africain.
Programme des étudiants (300 h)
30 heures dans la rubrique 1
30 heures dans la rubrique 2
30 heures dans la rubrique 3
30 heures à choisir parmi les activités " ouvertes " des autres filières.
NB. Des aménagements au programme type de l'étudiant peuvent être sollicités auprès de la Commission de gestion de l'Ecole doctorale
Filière " Cognition, communication et interventions cliniques"
Cette filière est consacrée à l'étude des fonctions cognitives dans la perspective d'interventions cliniques. Il s'agit aussi bien de l'apport de la psychologie cognitive à la psychologie clinique que de l'abord clinique des pathologies de la cognition. La filière accueille des étudiants qui s'intéressent tous les aspects de lka cognition au sens large dans une perspective d'intervention psychologique. Il s'agit de fournir aux étudiants qui ont en commun le souci de l'intervention clinique, une méthodologie et un cadre théorique particuliers. La méthodologie concerne les problèmes spécifiques de la recherche dans ce domaine (recherche bibliographique et méta-analyse, méthodologie du cas unique, méthodologie de l'essai clinique, techniques de présentation et de publication). Une insistance particulière est mise sur la communication, les émotions, le langage, la mémoire et les processus d'apprentissage en tant qu'objets et moyens de l'intervention. La bonne marche de la filière est assurée par un groupe de membres des unités Cognition et développement, Psychologie clinique : émotion; cognition, santé et Neurosciences cognitives.
Programme des étudiants (300 h)
30 heures dans la rubrique 1
30 heures dans la rubrique 2
30 heures dans la rubrique 3
30 heures à choisir parmi les activités " ouvertes " des autres filières.
NB. Des aménagements au programme type de l'étudiant peuvent être sollicités auprès de la Commission de gestion de l'Ecole doctorale.
Filière " Psychologie sociale "
L'unité de psychologie sociale clinique (ECSA) s'intéresse tout particulièrement aux émotions, d'un point de vue expérimental et clinique, en menant des recherches en laboratoire et sur le terrain comme dans les écoles et les hôpitaux. L'unité de psychologie sociale (PSOR), quant à elle, développe essentiellement des recherches expérimentales sur la perception sociale et les relations entre groupes. Les deux unités ont depuis toujours collaboré et travaillent ensemble pour le moment à un projet d'actions concertées sur les émotions et les relations inter-groupes.
Dans ce cadre, cinq chercheurs seniors encadrent une trentaine de doctorands subsidiés par l'université, le FRNS et la Communauté française de Belgique. La formation des chercheurs est directement liée aux problématiques citées. Elle s'inscrit dans un réseau international avec d'autres universités européennes et américaines et bénéficie des activités proposées par l'Association européenne de psychologie sociale expérimentale ainsi que par la Société européenne d'études des émotions.
Programme des étudiants (300 h)
30 heures à choisir parmi les séminaires à orientation thématique (rubrique 1)
60 heures à choisir parmi les séminaires " Confrontations empiriques et théoriques " (rubrique 2)
30 heures d'encadrement méthodologique (rubrique 3)
30 heures de formation à choisir parmi les activités " ouvertes " des autres filières.
NB. Des aménagements au programme type de l'étudiant peuvent être sollicités auprès de la Commission de gestion de l'Ecole doctorale.
Filière "Histoire, justice et société"
Le Centre d'histoire du droit et de la justice, reconnu en 2000 comme Unité du développement d'Histoire de l'UCL, rassemble depuis 1995, des chercheurs seniors de différentes universités et plusieurs doctorands, autour des questions d'histoire juridique et judiciaire inscrites dans une perspective de longue durée.
Le Centre s'inscrit dans un réseau européen (le CERN)) et international (l'International Association for the History of Crime and Criminal Justice) et ses membres collaborent activement à la revue "Crime, History & Societies. Crime, histoire et société".
La filière propose en unseignement de recherche et d'études approfondies des questions d'histoire pénale, objet de la majorité des thèses en cours dans le cadre du Centre. Formes, pratiques, acteurs, modèles et transformations de la justice en Occident depuis l'Antiquité tissent le fil conducteur de la filière proposée.
30 heures dans la rubrique 1
30 heures dans la rubrique 2
30 heures dans la rubrique 3
30 heures à choisir parmi les activités "couvertes" des autres filières
N.B. : Des aménagements au programme type de l'étudiant peuvent être sollicités auprès de la Commission de gestion de l'Ecole doctorale.
Programme d'études 2003-2004 >
Ecoles doctorales
>
NCC

Recherche - Aide
- Renseignements généraux
[UCL] [Pointeurs utiles]
![]()
Responsable : Jean-Louis Marchand