| 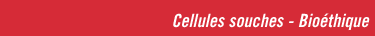
De la fécondation in vitro aux cellules souches : un challenge en perpétuelle mutation !
Pr. Jacques Donnez
7 octobre 2002 et 14 octobre 2002
Il y a déjà près d’un quart de siècle que Louisa Brown, premier "bébé éprouvette", est née.
Mises au point avant tout pour résoudre les problèmes de stérilité féminine, les techniques de procréation médicalement assistée devaient, dix ans plus tard, connaître un nouvel essor avec la technique appelée ICSI (micro-injection d’un spermatozoïde au sein de l’ovule) qui devait solutionner les problèmes de stérilité masculine et jeter quelque peu les banques de spermes aux oubliettes.
Les techniques de fécondation in vitro permettent non seulement à de nombreux couples consultant pour infertilité d’avoir un enfant, mais elles favorisent également l’accroissement des connaissances sur les premiers stades du développement embryonnaire et les étapes cruciales que sont les premières divisions déterminantes pour l’implantation de l’embryon. C’est à ce moment précis que le génome va être déterminé, responsable lui-même de la différenciation qui va conduire à un être humain.
De plus, il est actuellement possible de déterminer certains gènes et d’analyser les chromosomes de l’embryon. Cette technique impliquée dans le "diagnostic pré-implantatoire", est utilisée dans des indications bien précises, en accord avec le Comité d’éthique. Ces manipulations au niveau de l’embryon, en sélectionnant les embryons sains qui seront réimplantés, évitent aux patients porteurs d’anomalies géniques ou chromosomiques susceptibles d’induire des malformations fatales, d’avoir des enfants sains. La sélection des patients pouvant bénéficier de cette technique doit être effectuée avec la plus grande rigueur scientifique et éthique, afin d’éviter les dérives que suscite immédiatement la mise au point de telles techniques.
Plus récemment, l’étude de l’embryon, notamment au stade de blastocyste et de la formation du bouton embryonnaire (amas de cellules qui va former l’embryon lui-même et plus tard le fœtus) a permis la mise en évidence des qualités tout à fait particulières des cellules qui, à un certain stade, sont capables de se différencier en cellules bien particulières : cellules du myocarde, cellules hépatiques, neurones, etc. Ces cellules sont appelées les "cellules souches".
Les cellules souches embryonnaires sont considérées comme totipotentes. Elles ont en effet la capacité de se différencier en tous les types cellulaires d’un organisme. Elles sont en pratique prélevables sur des embryons constitués uniquement en vue de ce prélèvement ou sur des embryons qualifiés de surnuméraires. L’intérêt des cellules souches est considérable. Les recherches sont encore indispensables, mais il est évident que des avances thérapeutiques essentielles seront réalisées dans plusieurs domaines de la médecine. Préciser les conditions et les risques potentiels de l’utilisation thérapeutique des cellules souches est une mission essentielle du corps médical impliqué dans ces recherches.
Intervient également dans cette discussion le clonage : clonage de l’embryon, clonage à titre reproducteur, clonage de l’être adulte.
Une société en mutation ; en mutation scientifique ; en mutation éthique.
Bioéthique
Pr. Michel Dupuis
4 novembre 2002 et 18 novembre 2002
L'immense débat mené depuis peu autour de l'utilisation thérapeutique des cellules-souches humaines constitue un exemple extraordinaire de dilemme qui n'est pas sans rappeler les grandes questions éthiques mises en scène par la tragédie grecque.
Faire ou ne pas faire ? Utiliser ou ne pas utiliser ? Et à quelles conditions ? En vertu de quelle loi, humaine ou divine ? Et sous quelle surveillance ? La question des cellules-souches doit être approchée avec minutie mais aussi avec une largeur de vue suffisante, en sorte que l'on embrasse les tenants et aboutissants de la problématique, bien plus complexe encore que les problèmes strictement scientifiques qu'elle pose.
Il en va, pour tout dire, d'une réflexion critique sur l'état de nos sociétés, sur les valeurs défendues par nos démocraties et en particulier sur la réalité que nous attachons à l'idée de dignité humaine.
Au cours de ces deux leçons, nous étudierons d'abord le contexte sociétal général au sein duquel apparaît la question des cellules-souches. Il y sera question de démocratisation des conceptions et des attitudes, mais également d'industrialisation des ressources et des pratiques, et bien évidemment de sécularisation des convictions. La science devenue "technoscience" sera interrogée à son tour. Nous aborderons ensuite systématiquement les divers problèmes éthiques qui ne cessent d'apparaître, avec le souci de chercher à construire une "réponse en sagesse" à ce double appel de l'humain vulnérable - de l'humain à protéger de la maladie, et de l'humain à protéger de l'instrumentalisation pure et simple. |
